Ciné de proximité ?
8 mars 2007 | Youpress dans Culture
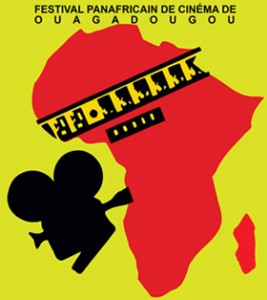
Affiche du Fespaco
À Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, la 20e édition du Fespaco a démontré la vitalité du cinéma africain, qui peine pourtant à s’exporter en France. Reportage.
Il y a foule, ce 25 février, à l’entrée du cinéma Neerwaya. Dans la chaleur et la poussière, des centaines de cinéphiles se pressent aux guichets pour assister à la projection d’Africa Paradis du réalisateur béninois Sylvestre Amoussou, en compétition officielle au Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou (Fespaco). La manifestation a débuté la veille. Dans la foule, des Burkinabés, des Sénégalais, des Sud-Africains mais aussi de nombreux Européens. Pendant une semaine, plusieurs milliers de professionnels sont réunis dans la capitale burkinabè pour un festival consacré strictement au cinéma africain. Une affluence et une vitalité difficile à imaginer en France, où ce cinéma représente moins de 2% des films projetés en salles. Une quasi-absence qui fait dire à certains professionnels que le cinéma africain n’existe plus.
« Africa Paradis » illustre bien cette contradiction. Le film rencontre un véritable succès au Fespaco, mais il n’est projeté que dans trois salles en France. « Si ce film est diffusé, c’est grâce à ces directeurs de salles qui nous ont fait confiance » explique Sylvestre Amoussou. « A l’origine, personne ne voulait de ce film ». Le réalisateur a mis dix ans à le produire, en s’appuyant sur ses fonds propres et sur des dons de la diaspora africaine. Au résultat, un film iconoclaste sur l’immigration, réalisé avec beaucoup d’humour. Pourtant, Sylvestre Amoussou semble mieux loti que ses camarades africains. A peine un quart des vingt films en compétition officielle bénéficie d’une diffusion en France ou en Europe.
Manque de moyens
Quand on interroge les professionnels présents à Ouagadougou sur ce problème, on obtient, au choix, des mines désolées ou des regards fuyants. Car le cinéma du continent noir cumule les difficultés : un nombre de productions insuffisant, de qualité inégale, aggravé par le désengagement progressif des bailleurs de fonds traditionnels indispensables à son existence (ministère des affaires étrangères français, organisation internationale de la francophonie et union européenne). En conséquence, explique le producteur français Claude Gilaizeau, « il est très difficile de trouver des distributeurs pour diffuser ces films, car ils savent qu’ils ne feront pas beaucoup d’entrées. Même un film comme « Daratt », qui a plutôt bien marché en France cette année, n’a fait que 50.000 entrées ».
Producteur de films africains depuis plus de 15 ans, il se dit « extrêmement pessimiste » sur l’avenir du cinéma africain francophone. Pour lui, le problème se situe au niveau des aides internationales qui non seulement diminuent, mais favoriseraient, en outre, un cinéma populaire plus proche du téléfilm que du cinéma de qualité. « Si on veut un cinéma africain capable de rivaliser au plan international, il faut y mettre les moyens ! » s’énerve-t-il. « Quand les budgets ne permettent de tourner que quinze jours, il ne faut pas s’étonner si le résultat est médiocre ».
Cinéma populaire ou films d’auteurs ?
Cinéma populaire ou cinéma d’auteur : le débat fait rage autour de la piscine de l’hôtel Indépendance, centre névralgique – et mondain – du Fespaco. Tout le monde ne partage pas le pessimisme de Claude Gilaizeau. Le réalisateur burkinabè Boubacar Diallo est un des chefs de file de ce fameux cinéma populaire, qu’il préfère qualifier « de proximité ». Au sein de sa structure des Films du Dromadaire, il a déjà réalisé cinq longs métrages, dont « Code Phenix », en compétition officielle. Son objectif n’est pas de diffuser ses films en Europe, mais en Afrique. « Il est paradoxal que des films africains financés à grands frais ne soient jamais diffusés sur le continent » constate-t-il. Son cheval de bataille : créer une industrie du cinéma africaine, proche des goûts des spectateurs. « Les films qui plaisent aux bailleurs de fonds occidentaux ne plaisent pas aux Africains. Ils ont une autre culture, une autre vision de l’Afrique » estime-t-il. Selon lui, c’est le public africain qui pourra sauver son cinéma.
Un point de vue minoritaire, mais que semble timidement rejoindre le ministère des affaires étrangères français. « Nous allons revoir notre mécanisme de soutien aux salles africaines, car notre bilan à ce niveau est plutôt faible » promet Richard Boidin, directeur de l’audiovisuel au ministère. La coopération française souhaite également soutenir davantage les téléfilms, pour favoriser « des programmes de proximité qui permettent aux Africains de se voir sur leurs propres écrans ».
Une politique qui fait bondir Claude Gilaizeau et beaucoup de réalisateurs africains. « Le public africain n’arrivera jamais à amortir ces films. Il n’y a pas assez de salles en Afrique, et les places sont vendues à moins d’un euro ». Mais il l’avoue lui-même, il n’y a pas de solution miracle. Entre des salles françaises trop encombrées, et un marché africain quasi-inexistant, des films d’une grande beauté semblent donc condamnés, pour l’instant, à n’exister que dans les festivals.